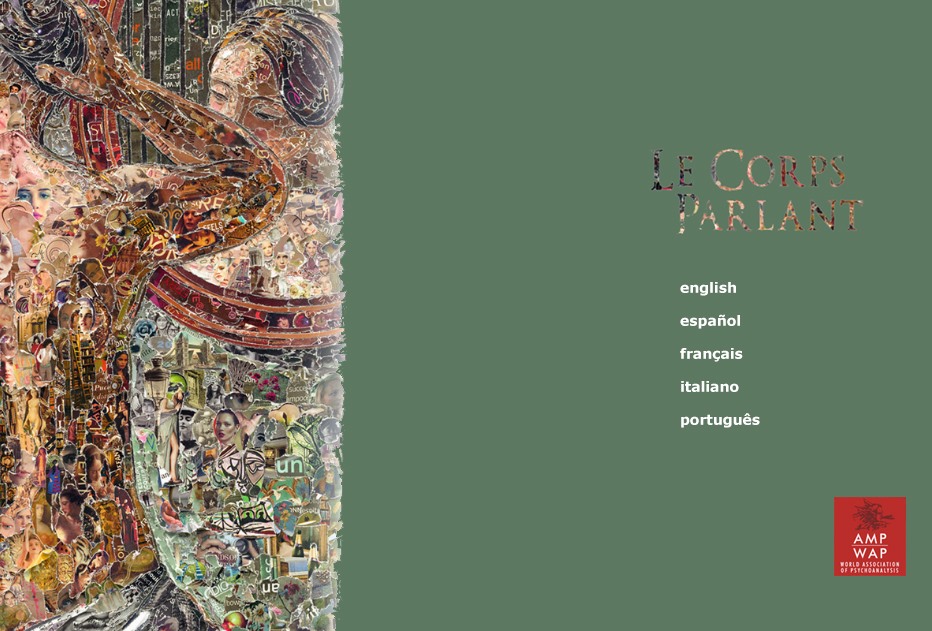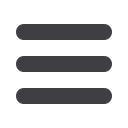

LE CORPS PARLANT
Xe Congrès de l’ AMP,
Rio de Janeiro 2016
203
202
boursouflure narcissique, qui est caractéristique de l’espèce, procède de ce défaut
d’identification subjective au corps. C’est spécialement dans l’hystérie que le
défaut d’identification corporelle a été mis en évidence. »
p. 13
Ni imaginaire, ni symbolique, mais vivant, voilà le corps qui est affecté de la
jouissance.
« Le corps vivant, qu’est-ce à dire ? Cela dit qu’il ne s’agit pas seulement du
corps imaginaire, du corps sous la forme de sa forme. Il ne s’agit pas du corps
image, de celui que nous connaissons, auquel nous nous référons parce qu’il est
opératoire dans le stade du miroir, ce corps spéculaire qui double l’organisme.
Il ne s’agit pas non plus du corps symbolique, celui qui à plusieurs reprises fait
venir sous la plume de Lacan la métaphore du blason. Les armoiries sont un
code. Des parties du corps peuvent certes y être représentées, d’ailleurs avec
d’autres éléments naturels, mais elles ont valeur de signifiants. Ce sont des
signifiants imaginaires, des signifiants dont la matière est empruntée à l’image.
Lorsque nous disons « le corps vivant », nous écartons ce corps symbolisé
comme aussi bien le corps image. Ni imaginaire, ni symbolique, mais vivant,
voilà le corps qui est affecté de la jouissance. Rien ne fait obstacle à ce que l’on
situe la jouissance comme un affect du corps. »
La question est de donner son sens à cet adjectif de vivant et aussi bien de saisir
par quel biais, de quelle incidence l’affect de jouissance advient au corps. »
p. 17
« Pour autant que la jouissance passe par le corps, la définition du symptôme
comme événement de corps est inévitable. »
« On admet que symptôme est jouissance, satisfaction substitutive d’une
pulsion, comme dit Freud – son caractère substitutif n’enlève rien à son caractère
authentique, réel, puisque la satisfaction substitutive n’est pas une satisfaction
moindre. Pour autant que le symptôme constitue une jouissance au sens de
satisfaction d’une pulsion, et pour autant que la jouissance passe par le corps,
qu’elle est impensable sans le corps, le corps comme forme ou plutôt comme
modalité, comme mode de la vie, la définition du symptôme comme événement
de corps est inévitable. »
p. 24
Le secret de la libido freudienne
« Pour cet anté-Lacan, on trouve dans ce décalage initial le secret de la libido.
Comme il s’exprime, nul besoin de chercher plus loin la source de l’énergie
libidinale, nul doute qu’elle ne provienne de la passion narcissique. Ce que
Freud nous laisse comme guide du moi, comme réservoir de la libido, Lacan
en rend compte par l’insertion, dans le morcellement initial de l’organisme, de
l’image totalisante du corps qui promeut l’image au centre de la vie psychique
du corps vivant de l’espèce humaine. C’est là qu’il trouve, avant d’être
structuraliste, le secret, la source de la libido freudienne. Il la trouve dans la
discorde, dans la discordance, dans la déhiscence. Cette libido narcissique est
une libido qui est vitale, positive, qui tire en avant le développement, qui est la
forme anticipée de la synthèse du corps, mais qui est en même temps agressive à
l’endroit de l’image. La démonstration que Lacan accomplit au sujet de ce stade
du miroir, c’est une libido qui inclut à la fois les valeurs de vie et de mort qui se
trouvent scindées chez Freud. Rapporter la libido à ce clivage, c’est conjoindre
les valeurs de vie et les valeurs de mort. »
p. 27
Des corps malades de la vérité
« L’exception dans le règne de la vie, ce sont les corps habités par le langage, qui
font vraiment tache dans l’animé, les corps de l’espèce humaine. C’est la honte
de la création parce que ce sont des corps malades de la vérité. Ils sont malades
parce que la vérité embrouille. La vérité variable, la vérité qui parle, la vérité
qui change, embrouille le rapport du corps avec le monde et avec le pur réel.
L’homme, les exemplaires de l’espèce humaine ne retrouvent un rapport net et
certain avec le réel que par le biais d’un autre savoir que le savoir du corps, et
qui est le savoir de la science. C’est seulement à devenir sujet de la science qu’il
parvient à ne pas se laisser embrouiller par la vérité et par son corps malade de la
vérité. »
p. 40
Refus du corps
« En quoi le corps est-il malade de la vérité dans l’espèce humaine ? La
psychanalyse a commencé par là, par s’intéresser à ces corps-là, aux corps qui
cessent d’obéir au savoir qui est en lui, qui cesse d’obéir au savoir que l’on peut
dire naturel. En effet, le corps est savoir et il obéit. C’est ce que François Jacob
appelle très bien «les algorithmes du vivant». L’idée ou le songe de l’âme traduit
le fait que le corps se présente comme Un et qu’il obéit. C’est pourquoi Lacan
a pu imaginer formuler que l’âme était du côté du manche. C’est l’équivalent
d’un signifiant-maître. La psychanalyse a pu commencer parce qu’elle s’est
souciée précisément de l’hystérie, et ce qui caractérise l’hystérie est que l’on y
rencontre le corps malade de la vérité. Freud l’a exprimé dans les termes du
refoulement et du retour du refoulé. Le corps hystérique est celui qui refuse le
diktat du signifiant-maître, le corps qui affiche son propre morcellement et qui
en quelque façon se sépare des algorithmes, du savoir inscrit dans sa substance.
C’est le phénomène que Freud appelait curieusement complaisance somatique
et que Lacan, dans sa perspective, nomme «refus du corps». C’est un double
refus dont il s’agit là dans le corps hystérique, par le corps hystérique. Cela veut
Jacques-Alain Miller