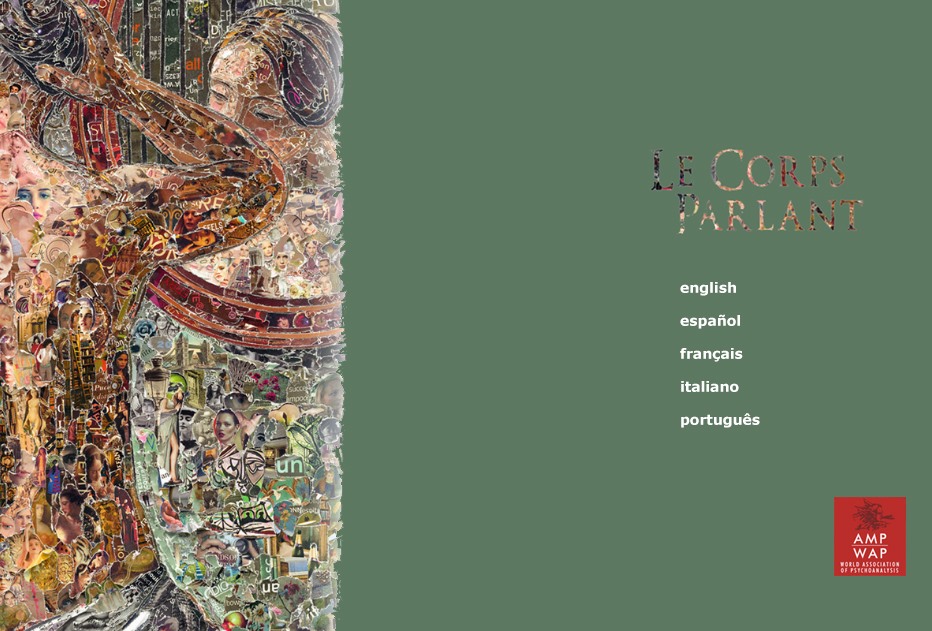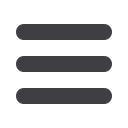

LE CORPS PARLANT
Xe Congrès de l’ AMP,
Rio de Janeiro 2016
191
190
Ainsi des individus qu’Aristote prend pour des corps, peuvent n’être rien que
symptômes eux-mêmes relativement à d’autres corps. Une femme par exemple,
elle est symptôme d’un autre corps. Si ce n’est pas le cas, elle reste symptôme dit
hystérique. »
p. 569
« Séance de clôture de la Journée d’étude sur les cartels de l’EFP »
(1975),
Lettre de l’Ecole freudienne de Paris
N°18, 1976
La consistance de l’imaginaire est liée à la séparation du corps de la
jouissance phallique
« L’imaginaire n’a aucune espèce d’autre support que ceci qu’il a le corps, et que
c’est en tant que ce corps se dénoue de la jouissance phallique que l’imaginaire a
consistance. »
p. 269
« Conférence à Genève sur le symptôme » (1975),
Le bloc-notes de la
psychanalyse
N°5, 1985
L’homme est capté par l’image du corps et fait l’Umwelt à l’image de son
corps
« Si l’homme – cela paraît une banalité que de le dire – n’avait pas ce que l’on
appelle un corps, je ne vais pas dire qu’il ne penserait pas, car cela va de soi, mais
il ne serait pas profondément capté par l’image de ce corps. L’homme est capté
par l’image de son corps. Ce point explique beaucoup de choses, et d’abord le
privilège qu’a pour lui cette image. Son monde, si tant est que ce mot ait un
sens, son
Umwelt
, ce qu’il y a autour de lui, il le corpo-réifie, il le fait chose à
l’image de son corps. »
p. 7
La rencontre de
lalangue
avec le corps
« C’est toujours à l’aide de mots que l’homme pense. Et c’est dans la rencontre
de ces mots avec son corps que quelque chose se dessine. (…) ce langage qui
n’a absolument pas d’existence théorique, intervient toujours sous la forme de
ce que j’appelle d’un mot que j’ai voulu faire aussi proche que possible du mot
lallation – lalangue. »
p. 11
« Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines »
(1975),
Scilicet
N°6 et Nº7, 1976
La parole a des effets sur le corps
« Entre le corps en tant qu’il s’imagine et ce qui le lie (à savoir le fait de parler)
l’homme s’imagine qu’il pense. Il pense en tant qu’il parle. Cette parole a des
effets sur son corps. Grâce à cette parole, il est presque aussi malin qu’un animal.
Un animal se débrouille fort bien sans parler. Le réel : rien que d’introduire ce
terme, on se demande ce qu’on dit. Le réel n’est pas le monde extérieur ; c’est
aussi bien l’anatomie, ça a affaire avec tout le corps. »
p. 40
L’homme a un corps car il le traite comme un meuble
« (…) ce sur quoi l’homme insiste, c’est non pas qu’il est un corps, mais, comme
il s’exprime (c’est là quelque chose de saisissant), qu’il en a un. Au nom de quoi
peut-il dire qu’il a un corps ? Au nom de ceci qu’il le traite à la va-comme-je-
te-pousse, il le traite comme un meuble. (…) Alors, je voudrais dire que cette
histoire de parlêtre, ça se rencontre avec cette autre appréhension du corps et ça
ne va pas tout seul. Je veux dire qu’un corps a une autre façon de consister que
ce que j’ai désigné là sous une forme parlée, sous la forme de l’inconscient, en
tant que c’est de la parole comme telle qu’il surgit. »
p. 49
L’homme adore son corps comme image qu’il appréhende comme un sac de
peau
« Cette apparence du corps humain, les hommes l’adorent. Ils adorent en
somme une pure et simple image. J’ai commencé à mettre l’accent sur ce que
Freud appelle narcissisme,
id est
le nœud fondamental qui fait que, pour se
donner une image de ce qu’il appelle le monde, l’homme le conçoit comme
cette unité de pure forme que représente pour lui le corps. La surface du corps,
c’est de là que l’homme a pris l’idée d’une forme privilégiée. Et sa première
appréhension du monde a été l’appréhension de son semblable. Puis ce corps, il
l’a vu, il l’a abstrait, il en a fait une sphère : la bonne forme. Cela reflète la bulle,
le sac de peau. »
p. 54
« L’insu que sait de l’Une-bévue s’aile à mourre : séances du 16
novembre et 14 décembre 1976 », Ornicar N°12 et N°13, 1977
Les trois corps
« Je me suis aperçu que consister voulait dire qu’il fallait parler de corps, qu’il y
a un corps de l’imaginaire, qu’il y a un corps du symbolique – c’est lalangue – et
un corps du réel dont on ne sait pas comment il sort. »
p. 7
Le corps comme trique ou tore retourné
« Ce tore n’a pas l’air d’être un corps mais vous allez voir qu’il suffit de le
retourner. »
p. 8
« Ce qu’on voit du corps vivant est organisé comme ce que l’autre jour j’ai
appelé trique et qui n’est rien d’autre qu’un tore. C’est à ça qu’aboutit ce que
nous connaissons du corps comme consistant. »
p. 12
Jacques Lacan