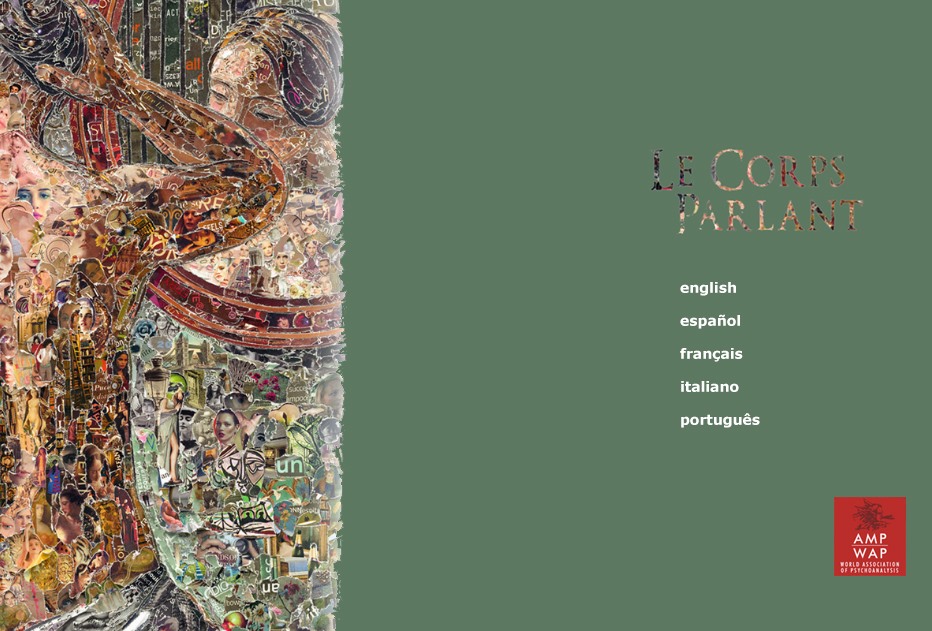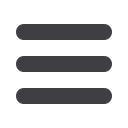
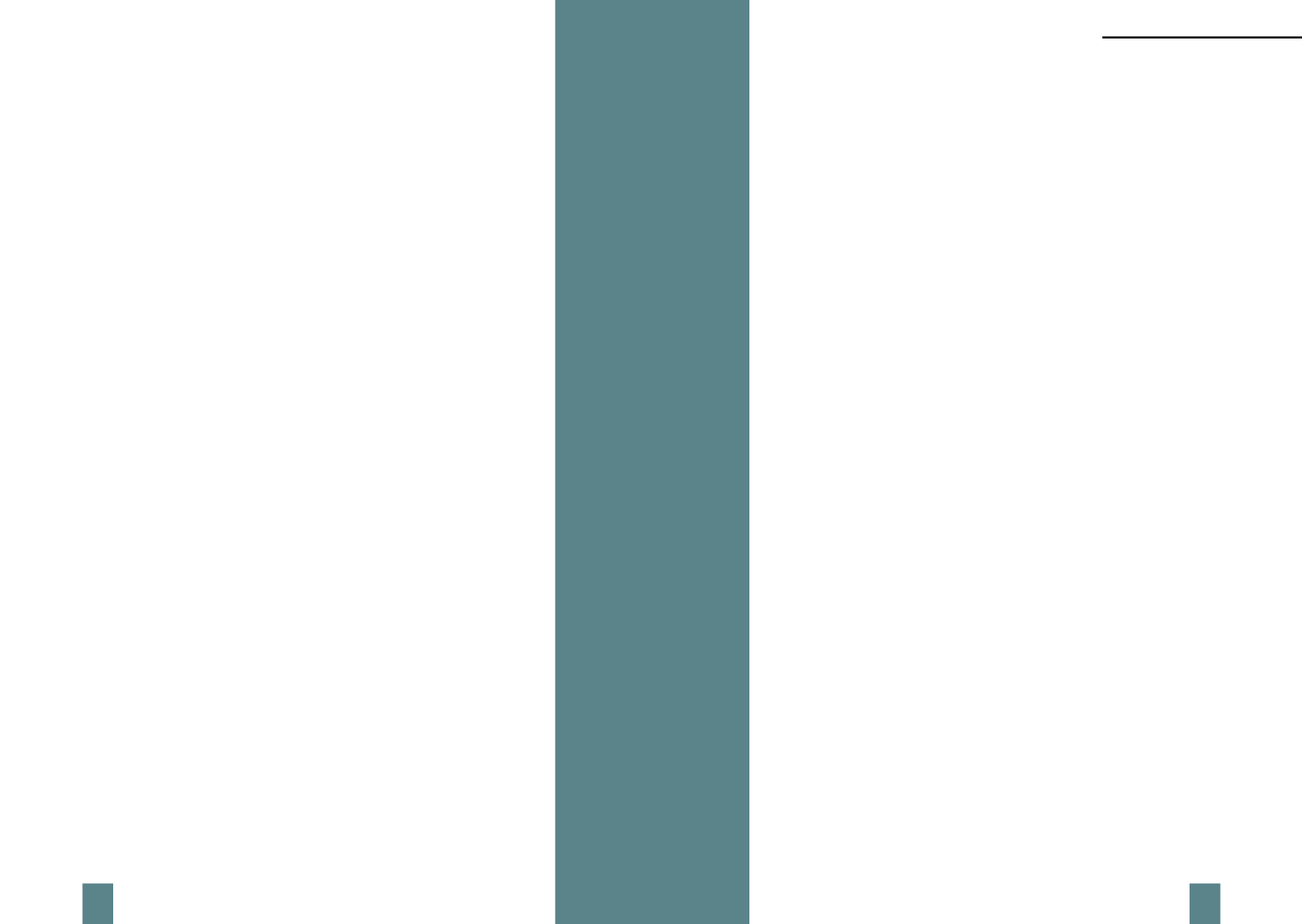
LE CORPS PARLANT
Xe Congrès de l’ AMP,
Rio de Janeiro 2016
173
172
identique au trait unaire, au petit bâton, à l’élément de l’écriture, d’un trait en
tant qu’il commémore une irruption de la jouissance. »
p. 89
Le corps perdu de l’esclave, lieu d’inscription de tous les autres signifiants
« Hegel ose partir, en effet, de la
Selbstbewusstsein
dans son énonciation la plus
naïve, à savoir que toute conscience se sait être conscience. Et pourtant, il tresse
ce départ avec une série de crises –
Aufhebung
, comme il dit - , d’où il résulte que
cette
Selbstbewusstsein
elle-même, figure inaugurale du maître, trouve sa vérité du
travail de l’autre par excellence, de celui qui ne se sait que d’avoir perdu ce corps,
ce corps même dont il se supporte, pour avoir voulu le garder dans son accès à
la jouissance, autrement dit l’esclave.(…) Plus simplement, il s’agit de ceci, qu’il
y a un usage du signifiant qui peut se définir à partir du clivage d’un signifiant-
maître avec ce corps dont nous venons de parler, le corps perdu par l’esclave
pour ne devenir rien d’autre que celui où s’inscrivent tous les autres signifiants. »
p. 101-102
Le refus du corps de l’hystérique
« Simplement, le discours de l’hystérique relève la relation du discours du maître
à la jouissance, en ceci que le savoir y vient à la place de la jouissance. Le sujet
lui-même, hystérique, s’aliène du signifiant-maître comme étant celui que ce
signifiant divise – celui, au masculin, représente le sujet -, celui qui se refuse à
s’en faire le corps. On parle à propos de l’hystérique de complaisance somatique.
Encore que le terme soit freudien, ne pouvons-nous nous apercevoir qu’il est
bien étrange ? – Et que c’est plutôt de refus du corps qu’il s’agit. A suivre l’effet
du signifiant-maître, l’hystérique n’est pas esclave. »
p. 107
« Adresse à l’école » (1969),
Autres écrits
. Paris, Seuil, 2001
Sélection d’un corps dit AE
« A en partir, nul n’est contraint de se soumettre à cet examen d’un
moment, qu’elle marque comme la passe : ceci parce qu’elle le redouble d’un
consentement à cet examen même, lequel elle pose comme épreuve de capacité à
prendre part à la critique comme au développement de la formation.
C’est cette liberté même qui impose la sélection d’un corps dit AE. Et s’il est
ainsi confluent au corps existant déjà sous ce titre, c’est qu’il n’y a aucune raison
de refuser à ce corps la capacité dont la nouvelle sélection se motive.
Il y a tout lieu au contraire qu’il en reçoive ici l’hommage.
Que cet hommage, tel le décline, pourquoi pas ? Qu’on applaudisse cette
démission comme un défi, nous rappelle que la démagogie ne saurait être
unilatérale. Il y faut aussi un public : ceci prouve qu’il ne manque pas. »
p. 294
I /c. Le mystère du corps parlant (197O-1977)
I /c.1 La lettre comme inscription de jouissance dans
le corps (1970-1973)
Le Séminaire
, Livre XVIII,
D’un discours qui ne serait pas semblant
(1970-71). Paris, Seuil, 1991
Le signifiant « corps morcelé »
« L’inconscient et son jeu, cela veut dire que, parmi les nombreux signifiants qui
courent le monde, il va y avoir en plus le corps morcelé. »
p. 16
La jouissance de la vie a un terme
« Le monde dit inanimé n’est pas la mort. La mort est un point, un point terme
de quoi ? – de la jouissance de la vie. »
p. 21
Le réel fait trou dans le discours scientifique
« L’articulation, j’entends algébrique, du semblant – et comme tel il ne s’agit
que de lettres – et ses effets, voilà le seul appareil au moyen de quoi nous
désignons ce qui est réel. Ce qui est réel, c’est ce qui fait trou dans ce semblant,
dans ce semblant articulé qu’est le discours scientifique…il n’a de référence que
l’impossible auquel aboutissent ses déductions. Cet impossible, c’est le réel. »
p. 28
Si la plainte ne souffrait pas, nous ne saurions pas qu’elle est vivante
« En effet, l’étoffe de toutes les jouissances confine à la souffrance, c’est même à
ça que nous reconnaissons l’habit. Si la plainte ne souffrait pas manifestement,
nous ne saurions pas qu’elle est vivante. »
p. 108
La jouissance ne rejoint la dimension du sexuel qu’à porter l’interdit sur le
corps de la mère
« Sa structure, la jouissance sexuelle ne la prend que de l’interdit porté sur la
jouissance dirigée sur le corps propre, c’est-à-dire, très précisément, en ce point
d’arête et de frontière où elle confine à la jouissance mortelle. Et elle ne rejoint la
Jacques Lacan